
En février 1975, les Presses Universitaires de Grenoble publiaient « Alternatives au nucléaire », contre-propositions de chercheurs de l’institut de l’énergie de Grenoble (IEJE). La présentation de cet ouvrage collectif indiquait ceci (extrait) : « Le Gouvernement Français vient de prendre la décision de mettre en chantier six tranches nucléaires en 1976 et autant en 1977. Par la suite, ce rythme de construction ne devrait pas faiblir, si l’on en croit les perspectives énergétiques officielles.
Jamais dans l’histoire de notre pays, une décision d’une telle importance n’a été prise après un débat d’aussi courte durée, limité à quelques responsables de l’administration et de l’industrie. Jamais les déclarations officielles sur l’importance de l’évaluation technologique n’ont paru aussi formelles ! Jamais, l’opinion publique n’a été tenue à ce point éloignée des sources d’information et d’un dialogue vrai avec les experts ».

Cinquante ans plus tard, débats publics, concertations publiques, enquêtes publiques, s’enchaînent pour permettre à la Françatomique de respecter formellement ses obligations légales.
En effet, la « relance » du nucléaire décidée par le président Macron ainsi que les projets nécessaires pour la mettre en œuvre (construction de nouveaux réacteurs nucléaires, lignes à très haute tension, nouvelles installations de la chaîne d’approvisionnement en combustible neuf et de traitement des combustibles usés, stockages de déchets radioactifs) obligent l’Etat, EDF, RTE, ORANO, l’ANDRA, à soumettre leurs plans et projets à la consultation du public. La Commission Nationale du Débat Public (CDNP) est « l’autorité administrative indépendante » qui les organise.
Mais le public est-il réellement informé de l’existence de ces procédures technocratiques et de l’ensemble des enjeux des plans et des projets concernés ? Toutes les informations allant à l’encontre de ces plans et projets sont-elles portées à la connaissance du public lors de ces débats, concertations et enquêtes ?
Un « dialogue vrai » entre le public et les experts est-il possible lorsqu’il y a un déséquilibre de traitement médiatique flagrant entre les informations favorables aux plans et projets et celles qui y sont défavorables ? On peut sérieusement en douter après deux débats publics et une concertation sur le plan de « relance » du nucléaire, organisés ou supervisés récemment par la CNDP.

En tout cas, suite à l’interruption prématurée du débat public sur le projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, dont une paire d’EPR2 à Penly, la commission d’éthique et de déontologie de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) indiquait dans un communiqué publié le 3 mars 2023 (extraits) :
« L’accélération importante actuelle de la transition énergétique européenne pour répondre aux impératifs de décarbonation de la production d’énergie a été accentuée par le conflit en Ukraine. Parmi les États européens, la France, en difficulté pour atteindre ses objectifs de production d’énergies renouvelables, sans pour autant y renoncer, a choisi de relancer la production d’électricité nucléaire.
L’urgence de la décarbonation ne doit pas conduire à négliger le temps de la réflexion sur les choix énergétiques faits ou à faire, y compris lorsque ces choix s’orientent vers le nucléaire. Ce dernier choix énergétique ne peut être dispensé d’une réflexion approfondie et partagée quant à ses conséquences compte-tenu des irréversibilités qu’il engage. Le choix de développer l’énergie nucléaire a des conséquences temporelles comparables à celles du changement climatique sans que le fardeau des conséquences des décisions d’aujourd’hui ne soit porté par ses décideurs. Plus encore, ce choix énergétique va accélérer le développement des installations nucléaires et multiplier les risques qui leurs sont associés.

Or, l’arrêt prématuré du débat national sur l’avenir du nucléaire est en contradiction avec l’impératif de réfléchir et de partager les conséquences de ce choix décisionnel, le débat n’ayant pu aborder les questions éthiques y afférant.
En réaction, la Commission d’éthique et de déontologie de l’IRSN, s’appuyant sur les valeurs de la Charte d’éthique et de déontologie de l’Institut, souligne l’extrême nécessité de construire et de maintenir un regard prospectif à moyen et long terme sur l’ensemble des enjeux de l’énergie nucléaire et de le partager avec la société. En effet, les incidences des choix d’aujourd’hui sur les générations futures sont significatives, et devront être évaluées en particulier sur le plan de la santé et de l’environnement.
De même, les incertitudes scientifiques qui accompagnent les conséquences à long terme des décisions prises aujourd’hui dans le domaine du nucléaire, ne peuvent être masquées. Une éthique de ces incertitudes doit offrir les décisions les plus éclairées possibles.».
Quelques mois plus tard l’IRSN était dissout dans l’Autorité de Sûreté Nucléaire. L’éthique et la déontologie ne font pas partie des priorités des décideurs de la politique nucléaire française. Au contraire, celle-ci s’accompagne de différentes formes de corruption, pratiquées de manière récurrente par l’industrie nucléaire française.

Nucléaire et corruptions multiples
Pour perdurer l’industrie nucléaire a besoin en permanence de nouveaux projets et d’argent pour les financer. Elle ne peut pas compter sur la production d’électricité nucléaire pour s’autofinancer car, dans une économie de marché, cette activité détruit systématiquement de la valeur. Une étude (« High-priced and dangerous : nuclear power is not an option for the climate-friendly energy mix ») de l’institut allemand pour la recherche économique, DIW, l’a démontré. L’énergie nucléaire, coûteuse et dangereuse, n’est pas une option crédible pour un mix énergétique qui préserve le climat.
Elle a donc besoin de soutiens et de relais puissants au sein de l’appareil d’État pour obtenir des commandes et des financements publics.
Elle a aussi besoin d’une adaptation permanente des lois et règlements pour les conformer à ses intérêts. C’est une cause majeure de corruption de la démocratie.

Mais à l’extérieur du pays, il y a aussi des corruptions plus classiques de dirigeants des pays fournisseurs ou clients, réels ou potentiels, de l’industrie nucléaire. Des faits de corruption avérée, liés aux activités minières par exemple, sont révélés épisodiquement dans la presse. Le dernier concerne Areva qui a accepté de payer, le 9 décembre 2024, une amende de 4,8 millions d’euros contre l'abandon de poursuites pour corruption en Mongolie.
Une convention judiciaire d'intérêt public, conclue avec le Parquet national financier français, a permis à Areva d’éviter enquête judiciaire, jugement et condamnation. Les articles 42, 43, 44 et 45, de cette convention indiquent ceci :
« Au terme de l’enquête, les avantages tirés des manquements sont évalués à la somme de 4 000 000 €. En l’absence de capacité à établir la rentabilité économique du projet stratégique d’implantation, que ce soit à l’origine ou, dans son ensemble depuis lors, ce montant a été évalué à hauteur du montant qu’AREVA MINES SA s’était engagée à verser à EUROTRADIA contractuellement. La part afflictive de l’amende tient compte des facteurs majorants suivants : la taille de l’entreprise, s’agissant d’un acteur mondial de référence de la filière nucléaire à l’époque des faits ; l’utilisation d’un intermédiaire commercial [EUROVIA] concourant à la dissimulation des agissements ; l’implication d’agents publics de haut niveau ; le trouble grave à l’ordre public occasionné par ces faits. »
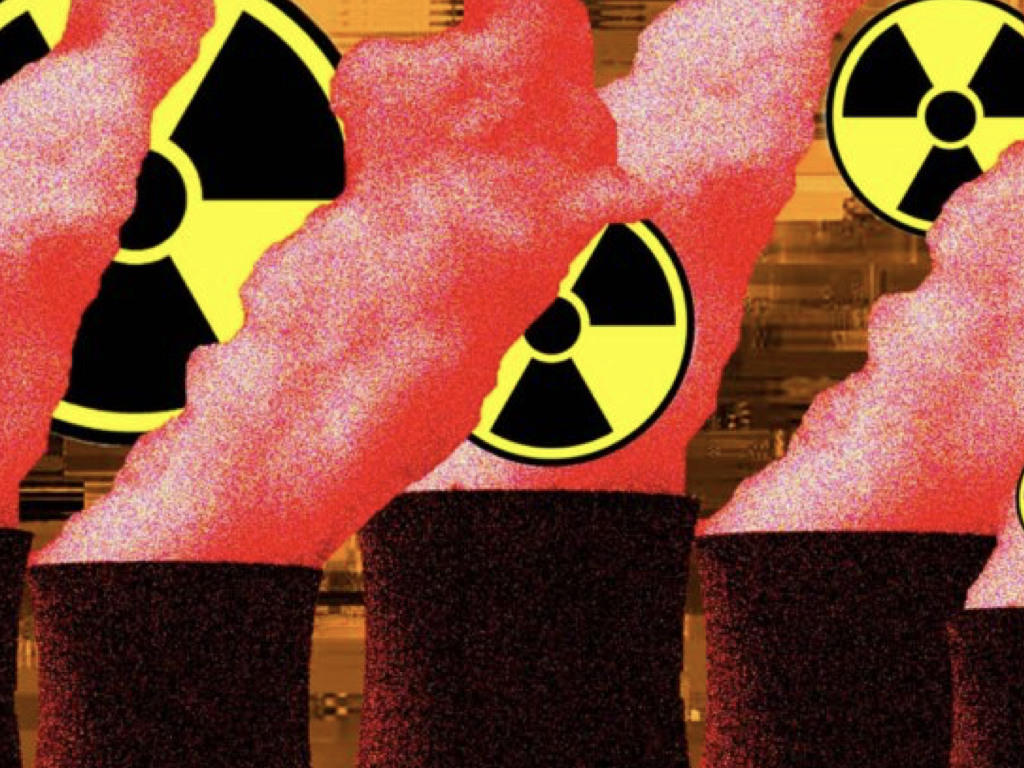
A l’intérieur du pays, l’industrie nucléaire exerce aussi une forme de corruption morale, bien que légale. Elle consiste à arroser d’argent public et de taxes les territoires nucléarisés ou à nucléariser. Sans parler des subventions diverses aux associations locales. Le but est d’obtenir en retour un soutien actif des projets de nouvelles installations nucléaires (réacteurs de production d’électricité, installations de
« traitement » et de stockage de déchets nucléaires, etc.). Les mécanismes utilisés sont décrits dans une étude du chercheur Teva Meyer, publiée par la revue Hérodote en décembre 2014 (Du « pays perdu » du Blayais à l’« émirat de Saint-Vulbas » : les territoires de dépendance au nucléaire en France »).

Dans la conclusion de cette étude on peut lire ceci (extrait) : « Mais les réacteurs nucléaires ne sont que la part la plus visible de l’industrie atomique française. Les 456 entreprises actives dans la filière, réparties dans 64 départements, représentent potentiellement autant de territoires de défense de l’énergie atomique et d’acteurs dans le débat. C’est dans le dense maillage du pays par cette industrie, situation mondialement unique, que l’on peut trouver une des explications à l’exceptionnalité de l’électronucléaire en France. »
Enfin, une dernière forme de corruption est celle qui consiste à utiliser une armada de lobbyistes et d’influenceurs pour orienter les décisions des députés et sénateurs, d’une part, pour tromper le « grand public » sur la réalité des activités de l’industrie nucléaire, d’autre part.

 En février 1975, les Presses Universitaires de Grenoble publiaient « Alternatives au nucléaire », contre-propositions de chercheurs de l’institut de l’énergie de Grenoble (IEJE). La présentation de cet ouvrage collectif indiquait ceci (extrait) : « Le Gouvernement Français vient de prendre la décision de mettre en chantier six tranches nucléaires en 1976 et autant en 1977. Par la suite, ce rythme de construction ne devrait pas faiblir, si l’on en croit les perspectives énergétiques officielles.
Jamais dans l’histoire de notre pays, une décision d’une telle importance n’a été prise après un débat d’aussi courte durée, limité à quelques responsables de l’administration et de l’industrie. Jamais les déclarations officielles sur l’importance de l’évaluation technologique n’ont paru aussi formelles ! Jamais, l’opinion publique n’a été tenue à ce point éloignée des sources d’information et d’un dialogue vrai avec les experts ».
En février 1975, les Presses Universitaires de Grenoble publiaient « Alternatives au nucléaire », contre-propositions de chercheurs de l’institut de l’énergie de Grenoble (IEJE). La présentation de cet ouvrage collectif indiquait ceci (extrait) : « Le Gouvernement Français vient de prendre la décision de mettre en chantier six tranches nucléaires en 1976 et autant en 1977. Par la suite, ce rythme de construction ne devrait pas faiblir, si l’on en croit les perspectives énergétiques officielles.
Jamais dans l’histoire de notre pays, une décision d’une telle importance n’a été prise après un débat d’aussi courte durée, limité à quelques responsables de l’administration et de l’industrie. Jamais les déclarations officielles sur l’importance de l’évaluation technologique n’ont paru aussi formelles ! Jamais, l’opinion publique n’a été tenue à ce point éloignée des sources d’information et d’un dialogue vrai avec les experts ». Cinquante ans plus tard, débats publics, concertations publiques, enquêtes publiques, s’enchaînent pour permettre à la Françatomique de respecter formellement ses obligations légales.
En effet, la « relance » du nucléaire décidée par le président Macron ainsi que les projets nécessaires pour la mettre en œuvre (construction de nouveaux réacteurs nucléaires, lignes à très haute tension, nouvelles installations de la chaîne d’approvisionnement en combustible neuf et de traitement des combustibles usés, stockages de déchets radioactifs) obligent l’Etat, EDF, RTE, ORANO, l’ANDRA, à soumettre leurs plans et projets à la consultation du public. La Commission Nationale du Débat Public (CDNP) est « l’autorité administrative indépendante » qui les organise.
Mais le public est-il réellement informé de l’existence de ces procédures technocratiques et de l’ensemble des enjeux des plans et des projets concernés ? Toutes les informations allant à l’encontre de ces plans et projets sont-elles portées à la connaissance du public lors de ces débats, concertations et enquêtes ?
Un « dialogue vrai » entre le public et les experts est-il possible lorsqu’il y a un déséquilibre de traitement médiatique flagrant entre les informations favorables aux plans et projets et celles qui y sont défavorables ? On peut sérieusement en douter après deux débats publics et une concertation sur le plan de « relance » du nucléaire, organisés ou supervisés récemment par la CNDP.
Cinquante ans plus tard, débats publics, concertations publiques, enquêtes publiques, s’enchaînent pour permettre à la Françatomique de respecter formellement ses obligations légales.
En effet, la « relance » du nucléaire décidée par le président Macron ainsi que les projets nécessaires pour la mettre en œuvre (construction de nouveaux réacteurs nucléaires, lignes à très haute tension, nouvelles installations de la chaîne d’approvisionnement en combustible neuf et de traitement des combustibles usés, stockages de déchets radioactifs) obligent l’Etat, EDF, RTE, ORANO, l’ANDRA, à soumettre leurs plans et projets à la consultation du public. La Commission Nationale du Débat Public (CDNP) est « l’autorité administrative indépendante » qui les organise.
Mais le public est-il réellement informé de l’existence de ces procédures technocratiques et de l’ensemble des enjeux des plans et des projets concernés ? Toutes les informations allant à l’encontre de ces plans et projets sont-elles portées à la connaissance du public lors de ces débats, concertations et enquêtes ?
Un « dialogue vrai » entre le public et les experts est-il possible lorsqu’il y a un déséquilibre de traitement médiatique flagrant entre les informations favorables aux plans et projets et celles qui y sont défavorables ? On peut sérieusement en douter après deux débats publics et une concertation sur le plan de « relance » du nucléaire, organisés ou supervisés récemment par la CNDP.
 En tout cas, suite à l’interruption prématurée du débat public sur le projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, dont une paire d’EPR2 à Penly, la commission d’éthique et de déontologie de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) indiquait dans un communiqué publié le 3 mars 2023 (extraits) :
« L’accélération importante actuelle de la transition énergétique européenne pour répondre aux impératifs de décarbonation de la production d’énergie a été accentuée par le conflit en Ukraine. Parmi les États européens, la France, en difficulté pour atteindre ses objectifs de production d’énergies renouvelables, sans pour autant y renoncer, a choisi de relancer la production d’électricité nucléaire.
L’urgence de la décarbonation ne doit pas conduire à négliger le temps de la réflexion sur les choix énergétiques faits ou à faire, y compris lorsque ces choix s’orientent vers le nucléaire. Ce dernier choix énergétique ne peut être dispensé d’une réflexion approfondie et partagée quant à ses conséquences compte-tenu des irréversibilités qu’il engage. Le choix de développer l’énergie nucléaire a des conséquences temporelles comparables à celles du changement climatique sans que le fardeau des conséquences des décisions d’aujourd’hui ne soit porté par ses décideurs. Plus encore, ce choix énergétique va accélérer le développement des installations nucléaires et multiplier les risques qui leurs sont associés.
En tout cas, suite à l’interruption prématurée du débat public sur le projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, dont une paire d’EPR2 à Penly, la commission d’éthique et de déontologie de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) indiquait dans un communiqué publié le 3 mars 2023 (extraits) :
« L’accélération importante actuelle de la transition énergétique européenne pour répondre aux impératifs de décarbonation de la production d’énergie a été accentuée par le conflit en Ukraine. Parmi les États européens, la France, en difficulté pour atteindre ses objectifs de production d’énergies renouvelables, sans pour autant y renoncer, a choisi de relancer la production d’électricité nucléaire.
L’urgence de la décarbonation ne doit pas conduire à négliger le temps de la réflexion sur les choix énergétiques faits ou à faire, y compris lorsque ces choix s’orientent vers le nucléaire. Ce dernier choix énergétique ne peut être dispensé d’une réflexion approfondie et partagée quant à ses conséquences compte-tenu des irréversibilités qu’il engage. Le choix de développer l’énergie nucléaire a des conséquences temporelles comparables à celles du changement climatique sans que le fardeau des conséquences des décisions d’aujourd’hui ne soit porté par ses décideurs. Plus encore, ce choix énergétique va accélérer le développement des installations nucléaires et multiplier les risques qui leurs sont associés. Or, l’arrêt prématuré du débat national sur l’avenir du nucléaire est en contradiction avec l’impératif de réfléchir et de partager les conséquences de ce choix décisionnel, le débat n’ayant pu aborder les questions éthiques y afférant.
En réaction, la Commission d’éthique et de déontologie de l’IRSN, s’appuyant sur les valeurs de la Charte d’éthique et de déontologie de l’Institut, souligne l’extrême nécessité de construire et de maintenir un regard prospectif à moyen et long terme sur l’ensemble des enjeux de l’énergie nucléaire et de le partager avec la société. En effet, les incidences des choix d’aujourd’hui sur les générations futures sont significatives, et devront être évaluées en particulier sur le plan de la santé et de l’environnement.
De même, les incertitudes scientifiques qui accompagnent les conséquences à long terme des décisions prises aujourd’hui dans le domaine du nucléaire, ne peuvent être masquées. Une éthique de ces incertitudes doit offrir les décisions les plus éclairées possibles.».
Quelques mois plus tard l’IRSN était dissout dans l’Autorité de Sûreté Nucléaire. L’éthique et la déontologie ne font pas partie des priorités des décideurs de la politique nucléaire française. Au contraire, celle-ci s’accompagne de différentes formes de corruption, pratiquées de manière récurrente par l’industrie nucléaire française.
Or, l’arrêt prématuré du débat national sur l’avenir du nucléaire est en contradiction avec l’impératif de réfléchir et de partager les conséquences de ce choix décisionnel, le débat n’ayant pu aborder les questions éthiques y afférant.
En réaction, la Commission d’éthique et de déontologie de l’IRSN, s’appuyant sur les valeurs de la Charte d’éthique et de déontologie de l’Institut, souligne l’extrême nécessité de construire et de maintenir un regard prospectif à moyen et long terme sur l’ensemble des enjeux de l’énergie nucléaire et de le partager avec la société. En effet, les incidences des choix d’aujourd’hui sur les générations futures sont significatives, et devront être évaluées en particulier sur le plan de la santé et de l’environnement.
De même, les incertitudes scientifiques qui accompagnent les conséquences à long terme des décisions prises aujourd’hui dans le domaine du nucléaire, ne peuvent être masquées. Une éthique de ces incertitudes doit offrir les décisions les plus éclairées possibles.».
Quelques mois plus tard l’IRSN était dissout dans l’Autorité de Sûreté Nucléaire. L’éthique et la déontologie ne font pas partie des priorités des décideurs de la politique nucléaire française. Au contraire, celle-ci s’accompagne de différentes formes de corruption, pratiquées de manière récurrente par l’industrie nucléaire française. Nucléaire et corruptions multiples
Pour perdurer l’industrie nucléaire a besoin en permanence de nouveaux projets et d’argent pour les financer. Elle ne peut pas compter sur la production d’électricité nucléaire pour s’autofinancer car, dans une économie de marché, cette activité détruit systématiquement de la valeur. Une étude (« High-priced and dangerous : nuclear power is not an option for the climate-friendly energy mix ») de l’institut allemand pour la recherche économique, DIW, l’a démontré. L’énergie nucléaire, coûteuse et dangereuse, n’est pas une option crédible pour un mix énergétique qui préserve le climat.
Elle a donc besoin de soutiens et de relais puissants au sein de l’appareil d’État pour obtenir des commandes et des financements publics.
Elle a aussi besoin d’une adaptation permanente des lois et règlements pour les conformer à ses intérêts. C’est une cause majeure de corruption de la démocratie.
Nucléaire et corruptions multiples
Pour perdurer l’industrie nucléaire a besoin en permanence de nouveaux projets et d’argent pour les financer. Elle ne peut pas compter sur la production d’électricité nucléaire pour s’autofinancer car, dans une économie de marché, cette activité détruit systématiquement de la valeur. Une étude (« High-priced and dangerous : nuclear power is not an option for the climate-friendly energy mix ») de l’institut allemand pour la recherche économique, DIW, l’a démontré. L’énergie nucléaire, coûteuse et dangereuse, n’est pas une option crédible pour un mix énergétique qui préserve le climat.
Elle a donc besoin de soutiens et de relais puissants au sein de l’appareil d’État pour obtenir des commandes et des financements publics.
Elle a aussi besoin d’une adaptation permanente des lois et règlements pour les conformer à ses intérêts. C’est une cause majeure de corruption de la démocratie. Mais à l’extérieur du pays, il y a aussi des corruptions plus classiques de dirigeants des pays fournisseurs ou clients, réels ou potentiels, de l’industrie nucléaire. Des faits de corruption avérée, liés aux activités minières par exemple, sont révélés épisodiquement dans la presse. Le dernier concerne Areva qui a accepté de payer, le 9 décembre 2024, une amende de 4,8 millions d’euros contre l'abandon de poursuites pour corruption en Mongolie.
Une convention judiciaire d'intérêt public, conclue avec le Parquet national financier français, a permis à Areva d’éviter enquête judiciaire, jugement et condamnation. Les articles 42, 43, 44 et 45, de cette convention indiquent ceci :
« Au terme de l’enquête, les avantages tirés des manquements sont évalués à la somme de 4 000 000 €. En l’absence de capacité à établir la rentabilité économique du projet stratégique d’implantation, que ce soit à l’origine ou, dans son ensemble depuis lors, ce montant a été évalué à hauteur du montant qu’AREVA MINES SA s’était engagée à verser à EUROTRADIA contractuellement. La part afflictive de l’amende tient compte des facteurs majorants suivants : la taille de l’entreprise, s’agissant d’un acteur mondial de référence de la filière nucléaire à l’époque des faits ; l’utilisation d’un intermédiaire commercial [EUROVIA] concourant à la dissimulation des agissements ; l’implication d’agents publics de haut niveau ; le trouble grave à l’ordre public occasionné par ces faits. »
Mais à l’extérieur du pays, il y a aussi des corruptions plus classiques de dirigeants des pays fournisseurs ou clients, réels ou potentiels, de l’industrie nucléaire. Des faits de corruption avérée, liés aux activités minières par exemple, sont révélés épisodiquement dans la presse. Le dernier concerne Areva qui a accepté de payer, le 9 décembre 2024, une amende de 4,8 millions d’euros contre l'abandon de poursuites pour corruption en Mongolie.
Une convention judiciaire d'intérêt public, conclue avec le Parquet national financier français, a permis à Areva d’éviter enquête judiciaire, jugement et condamnation. Les articles 42, 43, 44 et 45, de cette convention indiquent ceci :
« Au terme de l’enquête, les avantages tirés des manquements sont évalués à la somme de 4 000 000 €. En l’absence de capacité à établir la rentabilité économique du projet stratégique d’implantation, que ce soit à l’origine ou, dans son ensemble depuis lors, ce montant a été évalué à hauteur du montant qu’AREVA MINES SA s’était engagée à verser à EUROTRADIA contractuellement. La part afflictive de l’amende tient compte des facteurs majorants suivants : la taille de l’entreprise, s’agissant d’un acteur mondial de référence de la filière nucléaire à l’époque des faits ; l’utilisation d’un intermédiaire commercial [EUROVIA] concourant à la dissimulation des agissements ; l’implication d’agents publics de haut niveau ; le trouble grave à l’ordre public occasionné par ces faits. »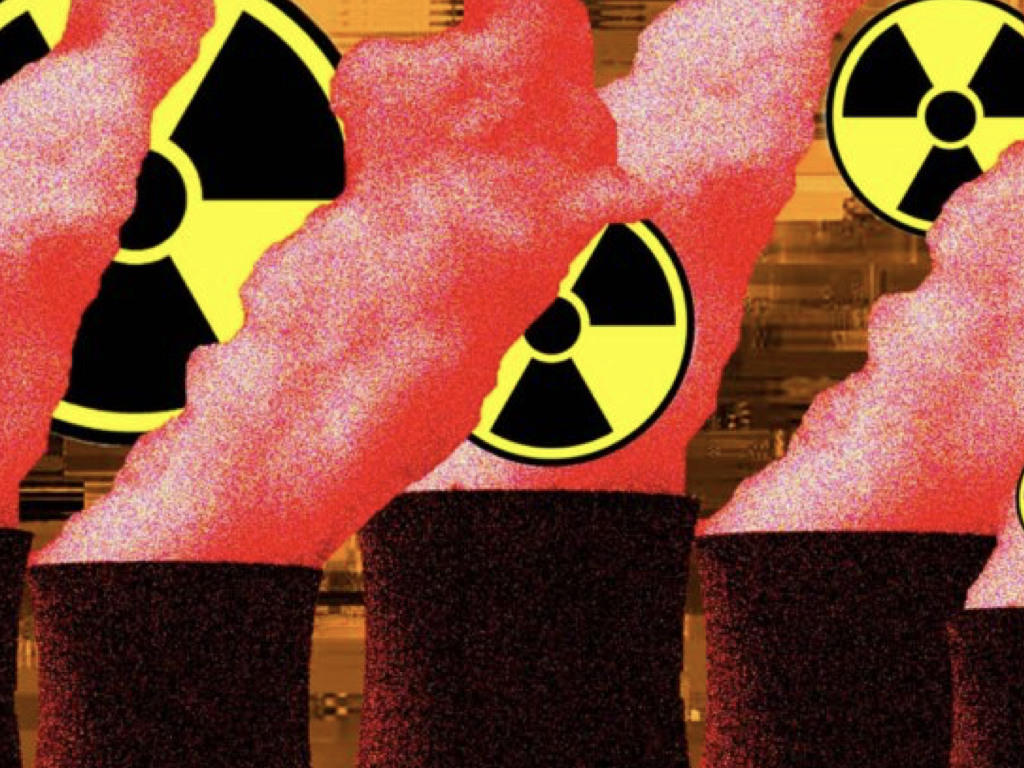 A l’intérieur du pays, l’industrie nucléaire exerce aussi une forme de corruption morale, bien que légale. Elle consiste à arroser d’argent public et de taxes les territoires nucléarisés ou à nucléariser. Sans parler des subventions diverses aux associations locales. Le but est d’obtenir en retour un soutien actif des projets de nouvelles installations nucléaires (réacteurs de production d’électricité, installations de
« traitement » et de stockage de déchets nucléaires, etc.). Les mécanismes utilisés sont décrits dans une étude du chercheur Teva Meyer, publiée par la revue Hérodote en décembre 2014 (Du « pays perdu » du Blayais à l’« émirat de Saint-Vulbas » : les territoires de dépendance au nucléaire en France »).
A l’intérieur du pays, l’industrie nucléaire exerce aussi une forme de corruption morale, bien que légale. Elle consiste à arroser d’argent public et de taxes les territoires nucléarisés ou à nucléariser. Sans parler des subventions diverses aux associations locales. Le but est d’obtenir en retour un soutien actif des projets de nouvelles installations nucléaires (réacteurs de production d’électricité, installations de
« traitement » et de stockage de déchets nucléaires, etc.). Les mécanismes utilisés sont décrits dans une étude du chercheur Teva Meyer, publiée par la revue Hérodote en décembre 2014 (Du « pays perdu » du Blayais à l’« émirat de Saint-Vulbas » : les territoires de dépendance au nucléaire en France »).  Dans la conclusion de cette étude on peut lire ceci (extrait) : « Mais les réacteurs nucléaires ne sont que la part la plus visible de l’industrie atomique française. Les 456 entreprises actives dans la filière, réparties dans 64 départements, représentent potentiellement autant de territoires de défense de l’énergie atomique et d’acteurs dans le débat. C’est dans le dense maillage du pays par cette industrie, situation mondialement unique, que l’on peut trouver une des explications à l’exceptionnalité de l’électronucléaire en France. »
Enfin, une dernière forme de corruption est celle qui consiste à utiliser une armada de lobbyistes et d’influenceurs pour orienter les décisions des députés et sénateurs, d’une part, pour tromper le « grand public » sur la réalité des activités de l’industrie nucléaire, d’autre part.
Dans la conclusion de cette étude on peut lire ceci (extrait) : « Mais les réacteurs nucléaires ne sont que la part la plus visible de l’industrie atomique française. Les 456 entreprises actives dans la filière, réparties dans 64 départements, représentent potentiellement autant de territoires de défense de l’énergie atomique et d’acteurs dans le débat. C’est dans le dense maillage du pays par cette industrie, situation mondialement unique, que l’on peut trouver une des explications à l’exceptionnalité de l’électronucléaire en France. »
Enfin, une dernière forme de corruption est celle qui consiste à utiliser une armada de lobbyistes et d’influenceurs pour orienter les décisions des députés et sénateurs, d’une part, pour tromper le « grand public » sur la réalité des activités de l’industrie nucléaire, d’autre part.






















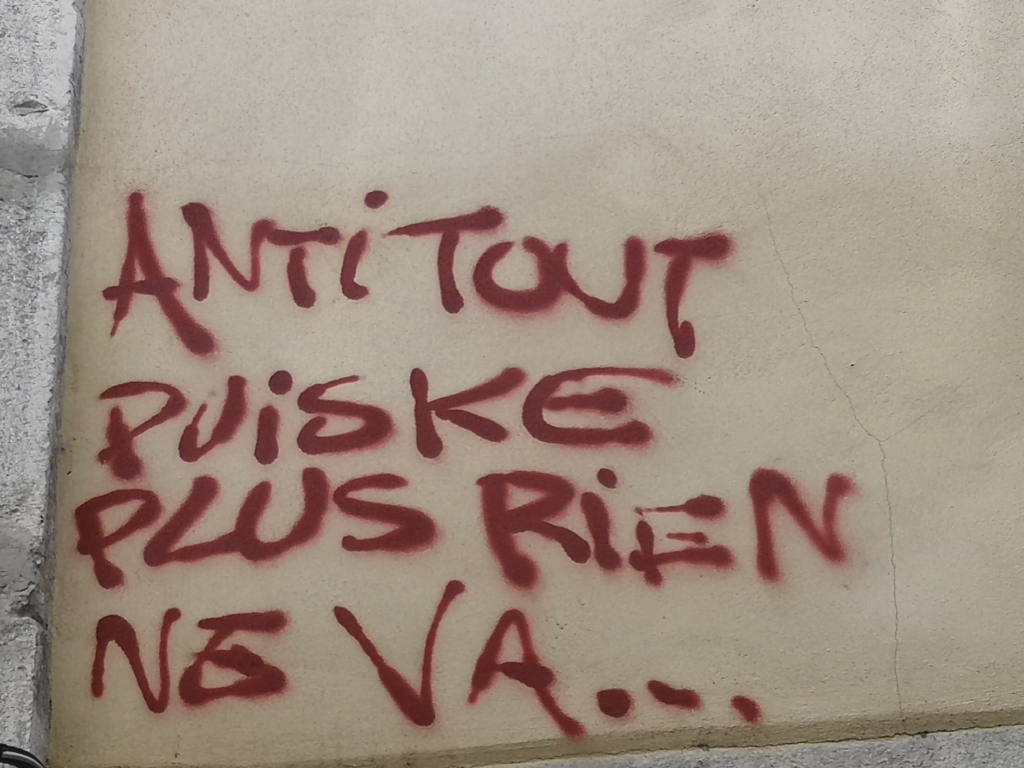





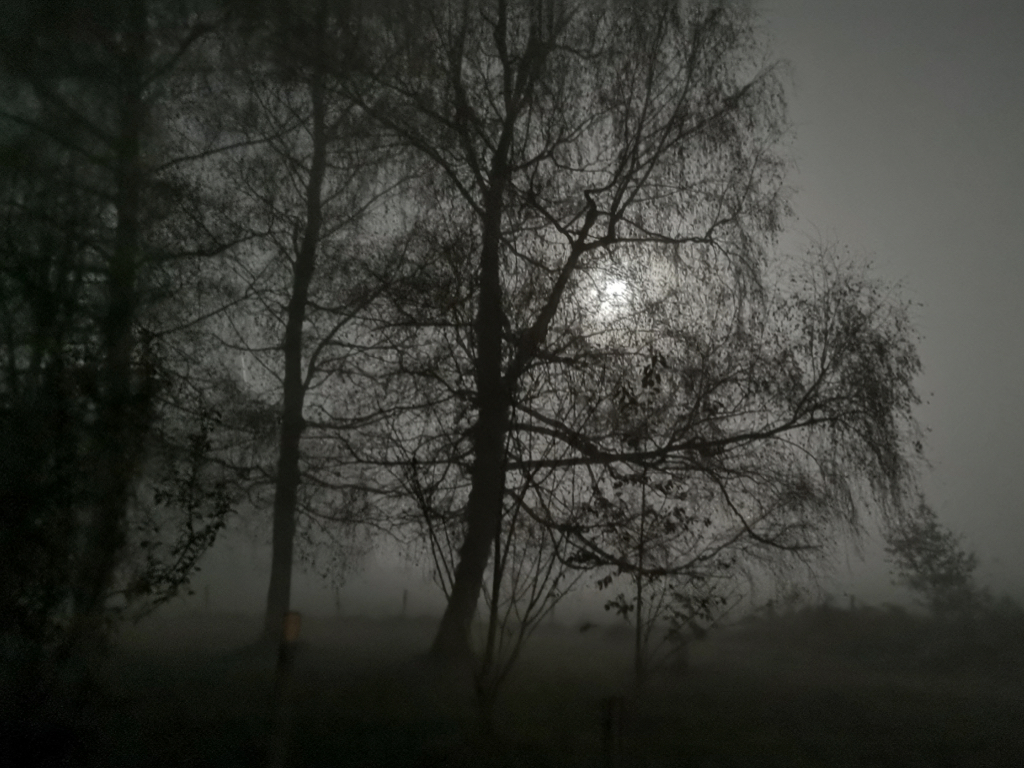






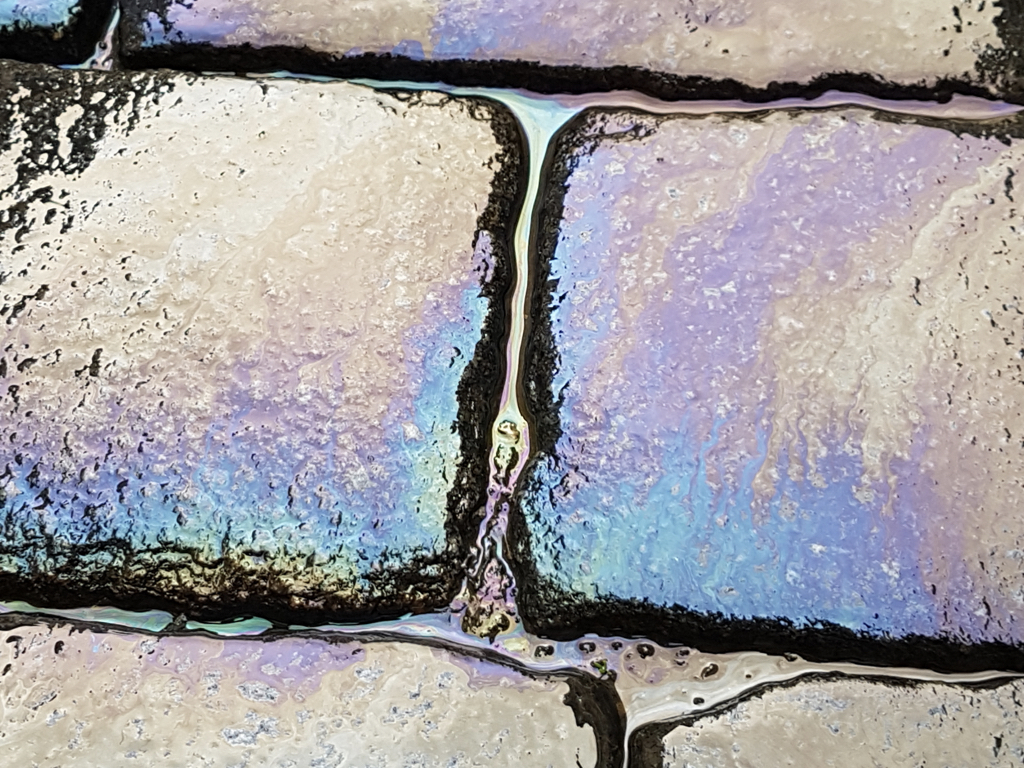



Commentaires